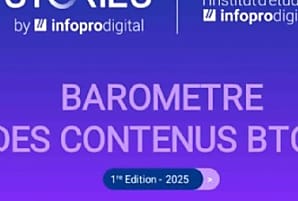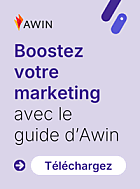Dominique Lévy :"La chose la plus inspirante, c'est le réel"
Ni un institut, ni une société de conseil, George(s) cultive son indépendance et sa liberté de ton depuis deux ans avec succès. Dans ce cabinet de curiosités lancé par deux sommités du secteur des études, complices et complémentaires, on livre bataille -intellectuelle- pour décrypter la société, ses tendances et ses contradictions. Présentation de ce collectif en ébullition avec sa co-fondatrice et co-présidente

Votre métier est à la frontière de nombreuses disciplines...
Les études, ce n'est pas un métier mais plusieurs. Pour conseiller nos clients, nous accumulons des signes de tous ordres (data, lectures, études...) puis nous proposons un angle étayé, une conviction à laquelle nous croyons, fruit de notre parcours et de nos cultures. Nous aidons nos clients à retrouver des marges de manoeuvre intellectuelles. Dans notre métier, on ne peut jamais fermer les écoutilles. Ce qui fait la spécificité de Geroge(s), c'est la séniorité de son équipe, son indépendance et une forme d'honnêteté intellectuelle. Nous sommes très attachés à cette forme de liberté de pensée et de parole, dont je constate qu'elle est finalement assez rare sur le marché.
George(s) est né début 2023. Comment va-t-il ?
Depuis 2 ans et demi, avec Édouard Lecerf, mon associé, nous avons travaillé pour environ 35 clients. Il y a eu des embauches. Fabrice Février qui codirige l'observatoire des médias à la Fondation Jean Jaurès, nous a rejoints en début d'année. Il a une fonction de vigie, d'observateur. Nous sommes six collaborateurs, ce qui est petit, mais nous cherchons avant tout à fabriquer un collectif très libre dans son organisation et dans son fonctionnement.
Pensez-vous que la pression exercée par D.Trump sur les politiques des entreprises en matière de DEI (diversité, équité, inclusion) peut avoir un impact en France ?
Depuis quelques années, beaucoup d'entreprises se sont positionnées sur des sujets d'engagement. Certaines l'ont fait par conviction, par éthique, d'autres par conformisme. C'est une vraie réflexion pour certaines dans leur façon de considérer les gens, mais chez beaucoup, cela n'était qu'une forme de vernis. Ce climat va permettre de trier le bon grain de l'ivraie. Les entreprises sont au pied du mur. Il est vrai que des clients nous interrogent sur ce sujet.
Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous êtes consulté au cabinet ?
Les marques ne viennent pas nous nous chercher sur des sujets opérationnels de marketing ou d'innovation... mais plutôt lorsqu'elles sont dans une réflexion, soit sur une cible, soit sur une problématique du type, « Qu'est-ce qu'une marque fédératrice dans une France fragmentée ? », « A quoi ressemble la famille aujourd'hui ? », « Qu'est-ce que c'est la masculinité aujourd'hui ? » Notre mission est d'essayer de comprendre la société française et de mettre cette compréhension au service des entreprises.
Concernant les tendances émergentes de la société, certains observateurs évoquent l'art de s'éviter en société...
C'est un sujet dont on parle dans notre étude « Françaises, Français », à savoir la difficulté de vivre avec la réalité. C'est même notre angle d'attaque. Nous expliquons que les Français sont bousculés dans leur rapport à trois choses, l'altérité, l'adversité et l'avenir. D'après Santé Publique France, un Français passe en moyenne 16 heures par jour à son domicile. Une des conséquences, c'est que l'autre devient une entité abstraite, alors que la rencontre est une expérience humaine fondamentale. Et cette expérience-là devient extrêmement rare. Pourtant, la chose la plus inspirante, c'est le réel.
Quel est notre rapport à l'adversité ?
Il y a de moins en moins d'institutions qui incarnent l'autorité. D'où la perte du sentiment de confiance. Or, ce qui fait le tissu social français, c'est le modèle social. Quelque chose se délite dans notre rapport à l'adversité. On a le sentiment de ne plus être protégé. Et donc il y a une demande de protection très forte adressée à l'État et à la chose publique. Cela renforce des comportements de protection et de repli sur soi. Chez moi ça va, ma famille ça va. Mais à l'échelle de la nation, ça ne marche pas. Cela impacte notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Car pour fabriquer un projet commun, il faut de la confiance en soi, dans les autres, dans les institutions. Il faut ne pas être nourri quotidiennement du récit du déclin, devenu malheureusement notre récit national.
Les marques ont-elles un rôle à jouer dans ce contexte ?
Contrairement à ce que m'a dit un jour la DG d'un groupe agroalimentaire, les marques ne vont pas sauver le monde ! Certaines jouent un rôle de réassurance, de ré-enchantement du réel, parce qu'il n'y a aucune marque qui vend du malheur. Pour autant, quelques-unes contribuent à la cohésion sociale comme la coopérative U, qui avec son histoire, ses valeurs, sa représentation locale et une notion de service rendu, qui joue un rôle positif. Quand on est une coopérative de commerçants implantés partout sur le territoire, à portée de vérification, on ne peut pas tricher. L'authenticité des marques est à l'épreuve des faits tout le temps. Certaines marques sont comme des phares, des repères... Renault et sa R5 électrique, même si elle n'a rien à voir avec la voiture de notre enfance, permettent de se projeter dans l'avenir en embarquant des souvenirs familiers...
Quelles sont les valeurs qui peuvent rassembler ?
Ce que nous observons à travers nos études c'est le besoin de reconnaissance et de dignité mais aussi de respect. Les Français veulent être entendus, avoir le sentiment d'être pris en considération par les pouvoirs publics, par les marques, par les autres, etc. C'est aussi une aspiration universelle à mener une vie une tranquille, à des relations apaisées. Et puis, au-delà des valeurs, il y a les comportements. Ceux des consommateurs qui décryptent les discours des marques, les rouages de la consommation pour consommer différemment.
Vous venez de réaliser une étude sur la cible des 35-50 ans. Pourquoi ?
Parce que ce sont les gens qui font tourner ce pays et dont on ne parle jamais. Ils sont 19 millions d'individus. Ceux qui ont 45 ans aujourd'hui, avaient 20 ans en l'an 2000 dans une France avec un taux de croissance de 3,9 % et un déficit public en dessous de 1,5 % ! Cette génération a vu arriver dans son paysage mental tous les sujets liés à la responsabilité, à l'inclusion, à l'environnement ; dans son paysage de consommation, le numérique pour le meilleur ou pour le pire et dans son paysage moral, de nombreux bouleversements au sujet de la famille, du couple, de la parentalité... Nous nous sommes aperçus que, partout dans le monde, les courbes du bien-être ressenti chutent entre 40 et 50 ans et remontent à partir de la soixantaine. C'est une génération silencieuse qui a vécu beaucoup de bouleversements. À ce titre, il est intéressant de l'observer.

Sur le même thème
Voir tous les articles Étude et Baromètre